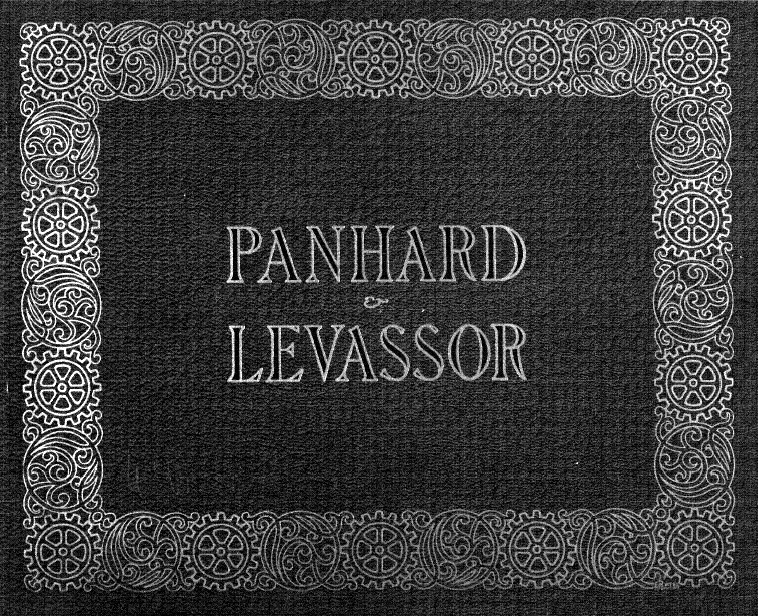1ère PARTIE
L’année 1911 nous donne un chiffre d’affaires évalué aux prix des tarifs, presque exactement pareil à celui de l’année précédente,
|
et Différence : |
26.800.000
26.670.000 130.000 |
frs pour 1911
frs pour 1910 |
|
et Différence en plus : |
22.780.000
22.380.000 700.000 |
pour 1911
pour 1910 pour 1911 |
Ce résultat provient de ce que les remises et rabais moyens ont été moins élevés cette année,
|
14,57 %
16,48 % |
cette année au lieu de
en 1910 |
Les dépenses totales ont été moins élevées cette année qu’en 1910 :
|
|
|
||
| Salaires
Frais généraux Marchandises |
3.656.028
3.754.470 10.037.356 17.447.854 |
3.889.848
3.791.810 11.078.338 18.759.996 |
|
|
Différence en moins |
pour 1911 : |
17.447.854
1.312.142 |
Les inventaires de marchandises sont pour :
| 1910 |
13.735.688
|
||
| 1911 |
14.541.146
|
||
| Soit en plus cette année : |
805.458
|
Cette augmentation correspond très sensiblement à la diminution des remises et rabais (1,90 %) consentis cette année sur les 26.800.000 de chiffre d’affaires évaluées aux tarifs.
Dans un ordre d’idées différent, en examinant le compte de profits et pertes, les bénéfices bruts de l’exploitation sont établis sans comprendre ni les frais généraux de fabrication, ni les dépréciations des machines outils, outillages et mobilier employés pour fabriquer. Ces dépréciations représentant en réalité la réserve qui doit être constituée pour permettre dans le courant des exercices le remplacement et le rajeunissement de l’outillage en général.
Pour l’établissement des prix de revient il est nécessaire de connaître exactement les frais généraux de fabrication tels qu’ils viennent d’être indiqués, c’est-à-dire en ajoutant aux frais généraux l’usure des machines outils et la création d’outillage qu’entraîne toute fabrication.
En réalité, en tenant compte de ces indications, le quantum
frais généraux et dépréciation à ajouter
aux salaires s’élève à :
|
pour
|
1910
|
4.101.764
|
|
|
1911
|
4.210.193
|
|
|
|
||
| Salaires |
3.889.848
|
3.656.028
|
|
| Frais généraux |
4.101.764
|
4.210.193
|
|
| Marchandises |
11.078.338
|
10.037.356
|
|
|
19.069.950
|
17.903.577
|
En 1910, nous avons travaillé davantage sur une marchandise vendue moins chère, le prix de revient n’est majoré pour obtenir le prix de tarif que de 40 %, en 1911 notre prix de revient est majoré de 49,5 %.
Comme la fabrication et la vente sont nécessairement décalées de plusieurs mois il est préférable dans le cas qui nous occupe, c’est-à-dire la détermination du quantum moyen de Frais Généraux à appliquer aux salaires, de prendre la moyenne de ces deux années.
En opérant ainsi on obtient :
| Ventes effectuées au tarif |
53.470.000
|
||
| Dépenses |
36.973.527
|
||
|
17.496.473
|
Cette majoration est destinée à couvrir les frais commerciaux et les remises consenties. Le reliquat constitue le bénéfice net de la société.
Nos frais commerciaux séparés depuis 4 ans de l’ensemble de nos frais généraux, représentent sensiblement 5 % soit en tout 20 % à retirer de la majoration, laquelle représente 32 % du prix de vente aux tarifs.
Le bénéfice réel restant disponible s’élève donc en moyenne à 12 % de ce même prix de vente.
Pour cette année 1911 les chiffres exacts sont :
| Chiffre d’affaires au tarif |
26.800.000
|
||
| Frais commerciaux |
4,5 %
|
||
| Remises consenties |
14,4 %
|
||
|
Total
|
18,9 %
|
Bénéfice 33 % - 18,9 % = 14,1 %
Ce qui fait apparaître un bénéfice réellement
disponible de :
|
|
|||
|
|
26.800.000 = 3.780.000 | ||
|
|
Ces quelques chiffres font ressortir l’intérêt qui s’attache à ne pas consentir des remises importantes avant d’avoir convenablement majoré les prix de revient. L’exemple de cette année nous montre que nous avons abandonné en moyenne par les remises ou bonifications diverses consenties aux intermédiaires, une somme supérieure aux bénéfices que nous conservons.
On ne saurait donc attacher une trop grande importance à ces questions lorsqu’on traite une affaire.
Les chiffres que nous venons de donner ne sont que les moyennes de l’ensemble des branches d’industries de notre Société ; nous allons examiner chacune d’elles en particulier pour préciser davantage ces différents points.
DÉPARTEMENT VOITURES
Comme les années précédentes nous mettons sous les yeux des membres du Conseil les différents graphiques qui résument pour chaque année les opérations de la société dans les différentes branches de ses travaux.
[NB : Les graphiques et tableaux qui accompagnaient ce rapport ont été
perdus.]
1° Châssis d’automobiles
2° Machines à travailler le bois
3° Lames de scies à ruban
4° Scies et fers de rabots.
CHÂSSIS D’AUTOMOBILES
Le chiffre d’affaire total de cette branche de la fabrication s’est élevé à la somme de :
|
21.049.232
|
|||
| se décomposant ainsi | |||
| Châssis et voitures |
17.080.714
|
||
| Pièces détachées |
3.252.260
|
||
| Réparations |
716.258
|
Le nombre des châssis ou voitures vendus s’est élevé à 1760 contre 1870 l’année passée ; ce nombre se décompose ainsi :
|
|
|
||
|
|
670
|
552
|
|
| Province |
520
|
312
|
|
| Angleterre |
243
|
712
Dont 500 fiacres |
|
| New York |
34
|
38
|
|
| Étranger |
293
|
256
|
|
|
1760
|
1870
|
À Paris, Seine, Seine et Oise, Seine et Marne, le nombre des voitures vendues a augmenté ; nous arrivons presque au chiffre le plus élevé atteint jusqu’ici : 704 en 1906.
Mais c’est surtout la Province qui marque une augmentation très
sérieuse dont la progression part de 1907 et suit une ascension
régulière :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ce résultat est dû à nos efforts en Province et
à l’apparition du type de voiture 12 chevaux dont la puissance bien
en rapport avec les besoins de la clientèle nous permet de lutter
avantageusement contre nos concurrents.
En Angleterre la vente des voitures malgré le S.S. ne s’est
pas sensiblement développée.
À New York la vente a été plutôt en décroissance ; l’année 1911 est moins bonne que la précédente, 34 au lieu de 38. Mais depuis le 1er Octobre, c’est-à-dire depuis la nouvelle gérance, les affaires semblent se relever ; 14 châssis ont été vendus contre 7 l’année précédente pendant la même période.
Enfin l’étranger est en légère augmentation.
Ces trois dernières régions sont l’objet des soins et des préoccupations de la partie commerciale. Ses efforts tendent à développer la représentation et nous attendons de bons résultats des dispositions qui ont été prises et sont en voie d’application par l’envoi de voyageurs.
Le second tableau montre les courbes des valeurs relatives par année
des prix de vente, prix de revient, puissance par châssis, bénéfices,
etc ...
Cette année le prix de vente moyen est remonté de 8.900
frs à 9.301 bien que les prix de tarif aient baissé. Ceci
provient de ce que la remise moyenne a été moins élevée
qu’en 1910 où nous avons livré des châssis pour fiacre
à un prix relativement bas.
Le prix moyen de fabrication est aussi un peu plus élevé.
La puissance moyenne par voiture aussi ; ces deux facteurs ont joué
parallèlement. Toutefois l’accroissement de la puissance moyenne
est peu importante bien que nous ayons fait moins de 12 Hp qu’en 1910 ;
cela tient à ce que nous avons vendu moins de voitures de puissances
supérieures à 20 Hp.
Enfin le bénéfice moyen passe de 2.310 en 1910 à
2.511 en 1911.
Le rapport du bénéfice au prix de revient continue à
remonter depuis 3 ans.
En résumé, l’examen des courbes réunies dans le
tableau indique que la marche des affaires de notre département
voitures a repris l’allure ascendante qu’elle possédait jusqu’en
1907.
Les salaires et les Frais Généraux ont progressé
dans les mêmes proportions et les achats de matières premières
sont restés stationnaires.
Par contre l’importance des marchandises en magasin a augmenté
; ceci résulte des nécessités de la vente. Il faut
donner plus de facilité qu’autrefois aux intermédiaires,
laisser les voitures en dépôt et surtout en carrosserie avant
de les débiter. Avant 1905 les matières et approvisionnement
à différents états d’usinage et de montage s’élevaient
à 35 % de la vente d’une année.
En 1911 cette proportion est de 64 % dont la moitié est représentée par des châssis mis en dépôt ou en carrosserie.
Ce fait que nous constatons provient de l’obligation où nous sommes de compter avec les nouvelles conditions du commerce automobile. Toutefois les conditions particulières dans lesquelles la société P.L. s’est trouvée, ont été rendues plus difficiles par les flottements qui se sont produits dans la ligne de conduite, en particulier en ce qui concerne les relations avec les intermédiaires.
Nous sommes d’avis que toutes ces relations doivent avant tout être établies sur des bases très simples, ne donnant lieu à aucune ambiguïté et établissant des situations très franches, dignes, en un mot, de la réputation d’honorabilité qui fait depuis de longues années une des principales forces de notre maison et que nous ne devons sous aucun prétexte laisser amoindrir.
La fabrication des châssis est pour notre société la principale branche de son industrie ; elle représente à elle seule presque les 9/10 du chiffre d’affaires réalisé chaque année ; aussi fait-elle l’objet de toute notre attention et de tous nos soins.
Les nécessités actuelles de la fabrication qui exigent des pièces de haute précision pour en assurer le bon fonctionnement et l’interchangeabilité, conduisent à l’emploi de méthodes de travail entraînant une coordination parfaite de tous les efforts.
Ces méthodes, tout en procurant les avantages qui viennent d’être énumérés, peuvent être économiques à la condition d’être appliquées à des travaux en grandes séries, ce qui ne peut être obtenu qu’à la condition de limiter autant que possible le nombre des types.
Pour réaliser des grosses économies dans la fabrication il faudrait pouvoir construire en grandes séries un nombre de types très limité. Nous l’avons déjà exposé dans nos rapports précédents et nous avons fait ressortir aussi le grand avantage qu’il y aurait au point de vue manutention à disposer de grands espaces pour approvisionner à pied d’œuvre et étaler les différentes pièces à l’emplacement même du montage de chaque machine. Le conseil a compris toute l’importance de cette considération et n’a pas hésité à faire le nécessaire en décidant la création d’un atelier de montage de près d’un hectare.
Malgré l’inconvénient résultant de la séparation de cet atelier de notre usine par l’avenue de Choisy (l’autorisation nécessaire au percement du tunnel projeté n’étant pas encore accordée par l’Administration de la Ville de Paris) nous n’hésitons pas à l’utiliser très prochainement à cause des grands avantages qu’il procurera pour le travail de montage.
La limitation du nombre des types de châssis est plus difficile à réaliser, du moins pour l’instant. Des changements s’imposent encore ; la voiture automobile n’est pas arrivée au degré de simplicité, de rusticité et de solidité que peut comporter et que doit réaliser un engin mécanique de cette nature.
Jusqu’à présent tous les travaux qui ont conduit à la conception des voitures automobiles actuelles ont été des études de recherches et d’analyses qui ont permis d’éclairer, de déblayer la voie et d’établir des comparaisons entre les multiples solutions réalisées.
Un travail de synthèse s’impose maintenant ; par éliminations successives on arrive à resserrer entre des limites bien tracées les procédés à employer pour obtenir les solutions simples, pratiques et robustes.
Les procédés qui se dégagent dès maintenant sont les suivants :
- Disposer les parties mécaniques essentielles (moteur et changement de vitesses) de manière à ce qu’elles ne subissent pas l’action des déformations élastiques (pas toujours hélas) que les voitures sont amenées à supporter.
- Soustraire à la poussière, à la boue et à l’eau la plus grande partie possible des organes mécaniques en mouvement.
- Pour obtenir la plus grande légèreté compatible avec la solidité et la durée indispensable de fonctionnement, soustraire le plus grand nombre d’organes aux efforts inconnus résultant de l’inertie de l’ensemble, c’est-à-dire ne pas leur faire supporter les efforts de freinage.
C’est sur ces données qu’ont été dirigées
depuis près d’un an les études et les essais. Dès
cette année un premier type de châssis comportant une puissance
moyenne de 15 chevaux se trouve réalisé sous deux formes
du moteur : à soupapes et sans soupapes.
Il restait à étendre ces dispositions à des puissances plus élevées ; toute la difficulté résidait dans l’embrayage. En effet, la réunion en un seul carter du changement de vitesse au moteur n’est possible qu’à la condition de ne pas avoir à intervenir pour assurer le bon fonctionnement de l’embrayage.
Par un dispositif breveté remplissant les conditions nécessaires, la difficulté est résolue.
Enfin un châssis plus faible (pour répondre à la demande de voitures légères) comportant un moteur de 70 d’alésage, à soupapes, aussi simple que possible, viendra pour 1913 compléter nos modèles courants qui se réduiront à 3 types de châssis tous à cardan.
Le type 6 cylindres de 100 d’alésage subsistera avec des modifications de détails que sa mise en service et la pratique pourront suggérer. Mais sa construction ne sera pas entreprise dans les mêmes conditions économiques que celle des 3 types courants dont il vient d’être question. Son prix sera donc relativement plus élevé.
L’emploi de la chaîne semble avoir fait son temps, même pour les poids lourds. La construction du tracteur nous a montré en effet l’intérêt qu’il y avait à soustraire aux intempéries et agents atmosphériques les organes mécaniques de ces voitures.
Des essieux moteurs pouvant supporter des charges de 2, 3 et 4 tonnes peuvent êtres construits et présenter le degré de résistance nécessaire pour ce genre de véhicules ; nos études sont entreprises en ce sens.
3ème PARTIE
MACHINES À TRAVAILLER LE BOIS
Le département des machines à travailler le bois a réalisé cette année un chiffre d’affaires tout à fait semblable à ceux des années précédentes, 825.547 frs, la moyenne des 11 dernières années étant de 885.000 frs, les variations en plus ou en moins d’une année à l’autre atteignent au plus 20 %.
Les bénéfices jusqu’à présent étaient positifs ; dans les deux dernières années ils se sont élevés à 6,5 % du chiffre d’affaires. Cette année ils sont négatifs – 149.000 frs.
Les raisons de cette situation sont multiples. À plusieurs reprises le conseil en a été saisi ; nous les résumons ainsi :
- 1° Outillage en grande partie ancien et ne permettant pas d’entreprendre la fabrication en série.
- 2° Personnel ouvrier dont le salaire plus fort que celui de nos concurrents établis en province entraîne à un prix de revient plus élevé des mêmes machines.
- 3° Enfin cette année l’établissement d’un nouveau modèle de scie à grume à fonctionnement entièrement automatique et représentant un progrès considérable dans ce genre de machine a augmenté les frais généraux. L’établissement des nouveaux modèles, les travaux de mise au point, les essais et les tâtonnements inévitables en pareille matière ont particulièrement cette année augmenté les dépenses de fabrication.
- 4° L’exposition de Turin succédant immédiatement à celle de Belgique a entraîné de fortes dépenses hors de proportion en réalité avec l’importance de cette fabrication.
- 5 ° La concurrence très active qui s’est établie entre les deux maisons Guillet ; celle d’Auxerre excessivement développée et bien outillée et celle de Fourchambault créée depuis 3 ans à peine, nous a forcé à réaliser des affaires à des prix peu rémunérateurs pour ne pas conserver en magasin des machines d’un modèle déjà ancien, exposées par conséquent à perdre de leur valeur, rapidement.
En résumé, d’après les courbes du tableau,
les salaires sont stationnaires depuis 6 ans, les achats de matières
premières ont diminué, mais les machines étant plus
perfectionnées ont une valeur plus grande, ce qui a fait remonter
le prix des marchandises en magasin.
Les ventes sont restées stationnaires et un peu inférieures cette années à la moyenne ; enfin, les Frais Généraux ayant augmenté par suite des circonstances énumérées plus haut, la balance s’est équilibrée par une perte au lieu d’un bénéfice.
Nous avons déjà entretenu le Conseil des mauvaises conditions dans lesquelles se trouve depuis longtemps cette branche de fabrication.
Au début de la société son chiffre d’affaires s’élevait à 550.000 frs seulement. Nous avons pensé alors qu’il était intéressant et utile de conserver et même de développer si possible une fabrication qui présentait à divers points de vue des avantages. Les machines à travailler le bois exigent une bonne construction et une exécution très soignée des parties mécaniques en mouvement à cause des grandes vitesses de rotation qui sont imprimées à certains organes de ces machines. Les problèmes de cinématique à résoudre dans la réalisation des résultats à obtenir, l’étude des conceptions mécaniques intéressantes auxquelles on est souvent conduit, nous ont paru être un excellent entraînement pour le personnel technique de toute l’usine.
Actuellement la plupart des modèles de machines sont nouveaux et nous avons conservé et pu maintenir la bonne réputation qui a fait autrefois le renom de la maison Panhard et Levassor ; encore maintenant, quand nous sommes appelés en concurrence, on nous donne souvent la préférence malgré un prix plus élevé. La scie à grume à marche automatique dont nous avons parlé plus haut constitue un progrès considérable et est très appréciée de la clientèle. La demande est telle que nous ne pouvons accepter toutes les commandes qui nous sont apportées.
Nous avions pensé à limiter notre production à la construction de cette scie. Mais la commande d’une telle machine entraîne généralement celle de plusieurs autres qui en sont le complément. Le client ne veut avoir à faire qu’à une seule maison. Nos moyens de production étant trop limités, nous sommes dans l’obligation de laisser passer des affaires très intéressantes.
Nous avons déjà examiné les conditions qu’aurait à remplir une organisation capable de produire un chiffre d’affaires sensiblement double, soit environ 1.500.000 frs.
Les marchandises en magasin pour répondre aux délais que réclament maintenant la clientèle s’élevaient à :
|
1.500.000
|
||
| Terrain nécessaire |
200.000
|
|
| Constructions |
300.000
|
|
| Matériel et outillage de toutes sortes |
600.000
|
|
| Disponibilités en caisse pour faire face aux découverts et constituer le fonds de roulement indispensable (salaires, matériels divers, etc.) |
600.000
|
|
| La société serait au capital de |
3.000.000
|
|
| Nous possédons déjà en marchandises |
800.000
|
|
| En terrain si nous allons à Reims |
200.000
|
|
| En matériel et outillage |
150.000
|
|
|
1.150.000
|
||
| La dépense monterait à |
1.850.000
|
Soit environ 2 millions dont il faudrait pouvoir disposer pour mettre cette fabrication dans les conditions que nous croyons nécessaires pour lui permettre de faire convenablement ses affaires.
Trois solutions se présentent :
- Agrandissement sur place à Paris (voir projet sur le plan)
- Construction à Reims sur notre terrain d’un atelier complet où serait transporté tout le matériel existant. Difficulté plus grande pour la main-d’œuvre. Organisation matérielle meilleure.
- Installation dans une usine à proximité de Paris entraînant achat de terrain et construction si on trouve une occasion ; ou achat du terrain et érection d’un atelier. Solution la plus chère.
C’est celui qui entraînera le moins de dépenses. L’économie du système consisterait à acquérir les quelques immeubles en bordure sur le boulevard Massénat et à construire un grand atelier sur l’emplacement des bâtiments et cours existants. Recrutement des ouvriers plus facile, mais main-d’oeuvre plus chère tout en étant de 1ère qualité.
4ème PARTIE
LAMES À RUBANS
Les chiffres d’affaires vont en augmentant bien que les prix de vente aient été en diminuant depuis plusieurs années. La production a augmenté comme l’indique l’augmentation croissante des matières premières achetées. Les salaires ont diminué, mais les frais généraux ont augmenté ; le rapport entre ces deux facteurs est pour ainsi dire l’indice d’une fabrication plus mécanique quand ces facteurs jouent dans le sens que nous indiquons.
L’emploi des machines à denter et des laminoirs à dresser ont en effet permis d’accroître dans une très forte proportion la production de la main-d’œuvre.
L’approvisionnement en magasin n’a pas très sensiblement varié, il est un peu augmenté depuis 4 ans pour permettre de répondre plus facilement aux commandes plus nombreuses ; mais il est encore insuffisant.
Les bénéfices moyens depuis 10 ans sont de 160.000 frs, ils s’élèvent cette année à 180.000 frs.
5ème PARTIE
SCIES ET FERS
Le chiffre d’affaires en décroissance depuis 3 ans s’est un peu relevé cette année, 107.221 frs contre 101.079 l’année dernière, moyenne des dix dernières années 116.500 frs.
Les salaires ont été en diminuant légèrement.
Les achats de marchandises restent stationnaires mais les frais généraux ont légèrement augmenté, ce qui pour cette année occasionne un bénéfice négatif de 4.328 frs alors que dans les deux années précédentes, il était positif et de 8 à 9.000 frs.
Cette augmentation des frais généraux peut provenir de deux causes :
- Nous avons serré de plus près la répartition des dépenses de Frais Généraux entre les différentes branches de notre fabrication.
- La mort de notre plus ancien voyageur survenue à la suite d’une longue maladie pendant la durée de laquelle nous avons dû le remplacer a entraîné de ce chef une dépense supplémentaire momentanée.