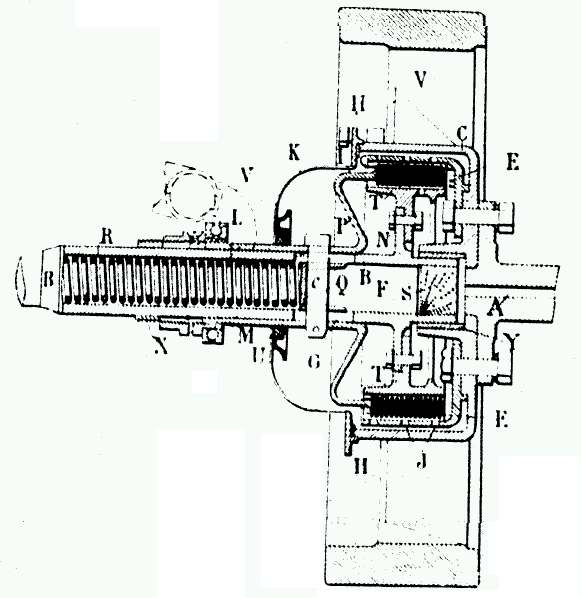-
Préface
-
Le châssis
 (pp
1 à 17) (pp
1 à 17)
p 1 - "Le chassis en bois armé se compose d'un cadre en frêne
ou en acacia, renforcé aux angles par des goussets ;les longerons
portent, solidement boulonnés, des flasques en tôle d'acier
à profil de poutre d'égale résistance. La maison Panhard-Levassor
a employé ce modèle pendant de longues années ..."
 (pp
18 à 24) (pp
18 à 24)
P 21 - "La maison Panhard met la roue à 90 centimètres
pour un moteur de 24 chevaux ..."
-
Ressorts et suspension
 (pp25
à 41) (pp25
à 41)
 (pp
42 à 61) (pp
42 à 61)
p 53 - "Il y a quelques années, la maison Panhard-Levassor
montait à l'avant de ses voitures de course un seul ressort transversal
dans le but de dégager complètement l'avant et de gagner
du poids ; l'essieu portait à la partie supérieure des pivots
de braquage, des douilles servant à recevoir les axes d'articulation
des jumelles du ressort transversal, celui-ci n'étant fixé
au chassis qu'en son milieu ; deux trous pratiqués dans le corps
de l'essieu, recevaient les extrémités articulées
de bielles fixées au châssis d'autre part. L'idée du
ressort transversal fut reprise par la Motor Vehicle Company, de
Chicago ..."
p 55 - "La suspension sur trois paires de roues, qu'avait déjà
employé le colonel Renard pour les véhicules composant
le train sur routes portant son nom, a été essayé
par quelque constructeurs."
-
Essieu avant
 (pp
62 à 79) - (pp
80 à 89) (pp
62 à 79) - (pp
80 à 89)
-
Mouvements de direction
 (pp
90 à 107) (pp
90 à 107)
p 92 - "Pour les fiacres omnibus, voitures de livraison, etc. il est
à souhaiter qu'on approfondisse la question des quatre roues dirtectrices.
[...]
Actuellement presque tous les essieux directeurs ont leur mouvement
d'articulation commandé par un quadrilatère formé
d'une bielle et de deux leviers (fig. 79), soit placé intérieurement
à la voiture (disposition Jeanteaud), soit extérieurement
(disposition Panhard-Levassor) ; [...]
p 97 - "... on peut remarquer que c'est dans le cas du quadrilatère
extérieur que cette position correspond au plus grand angle de rotation
; ... dans le cas du quadrilatère extérieur, la bielle a
b travaille à la traction, alors que dans le quadrilatère
intérieur, elle travaille à la compression ce qui est mauvais
surtout si cette barre n'est pas droite, si elle est cintrée comme
l'essieu ainsi qu'on le voit souvent ..."
 (pp
108 à 125) (pp
108 à 125)
-
Organes de commande de la direction
 (pp
126 à 143) (pp
126 à 143)
p 137 - "Directions à démultiplication par vis sans
fin. [...] La démultiplication est d'environ un cinquième
à un huitième. La maison Panhard-Levassor fut l'une des premières
à ce système, elle le monte sur ses voitures depuis 1895.
 (pp
144 à 165) (pp
144 à 165)
p 163 - "Presque toujours on remarque une ou deux manettes munies d'un
petit bouton, placée sur le volant de direction comme on
le voit sur les figures 126 et 127. Généralement l'une sert
à étrangler l'arrivée des gaz à l'aspiration
du moteur et l'autre sert à régler le moment de l'allumage
du mélange explosif."
 (pp
166 à 182) (pp
166 à 182)
-
Essieu arrière
 (pp
183 à 199) (pp
183 à 199)
 (pp
200 à 218) (pp
200 à 218)
p 207 - "Commandes particluières. ... le pignon hélicoïdal
B,
qui engrène avec la roue C calée sur la boîte
du différentiel, l'ensemble forme vis sans fin. ... on obtient
une transmission très douce, sans bruit et absolument réversible,
comme on peut le remarquer sur les quelques voitures munies de ce mécanisme
; où la vis B est en acier cémenté et trempé
et la roue C en bronze phosphoreux, le tout baignant continuellement
dans l'huile."
-
Freins
 (pp
219 à 235) - (pp
236 à 255) (pp
219 à 235) - (pp
236 à 255)
-
Carrosserie
 (pp
256 à 273) (pp
256 à 273)
p 224 - "Le moteur, surtout pour les longues descentes, peut également
servir de frein. [...] Si on ferme complètement l'admission, la
résistance du moteur est égale au tiers de la puissante qu'il
developpe normalement."
 (pp
274 à 284) (pp
274 à 284)
-
Table des matières
et Table Alphabétique
-
Postface
|
-
Préface
-
Embrayages
 (pp
1 à 19) (pp
1 à 19)
"[L'embrayage] doit être facilement manoeuvrable, donner un débrayage
instantané, entrer progressivement en travail, puis ne plus glisser
et, tout en étant simple et solide, c'est-à-dire sans risque
de panne, ne pas avoir une partie mobile de trop grande masse qui viendrait
gêner le débrayage."
 (pp
20 à 39) (pp
20 à 39)
 (pp
40 à 59) - (pp
60 à 79) (pp
40 à 59) - (pp
60 à 79)
p 64 - "La figure 41 représente l'embrayage Panhard-Levassor
...de plus l'embrayage est très progressif ... L'ensemble baigne
dans l'huile."
 (pp
80 à 97) (pp
80 à 97)
-
Changements de vitesses
 (pp
98 à 115) (pp
98 à 115)
p 98 - "Dans certains dispositifs, chaque paire d'engrenage est toujours
en prise, au point mort toutes les roues tournent folles ; pour rendre
l'une ou l'autre paire solidaire du mouvement moteur, on emploie soit des
griffes, soit des clavettes ou coins mobiles, soit de petits embrayages
à friction électriques ou même hydrauliques."
p 99 - "La prise directe a été très discutée
car, si en grande vitesse, en quatrèème par exemple, le rendement
est meilleur, les rendements des autres vitesses, troisième, deuxième,
etc., sont diminués, puisque quatre engrenanges entrent en travail.
[...]
Les roues dentées se font en acier doux ordinaire, ou à
faible teneur de nickel, cémenté et trempé, ou bien
en acier mangano-ciliceux trempé et recuit ..."
 (pp
116 à 135) - (pp
136 à 139) (pp
116 à 135) - (pp
136 à 139)
 (pp
140 à 155) (pp
140 à 155)
p 140 - "Changements de vitesse à trois baladeurs. [...]
Quelquefois, le mouvement est obtenu par un plateau à cames, comme
dans les Mercedes modèle 1903, certaines Panhard, Renault etc."
 (pp
156 à 175) - (pp
176 à 195) (pp
156 à 175) - (pp
176 à 195)
 (pp
196 à 215) (pp
196 à 215)
p 200 - "Changements de vitesse avec engrenages toujours en prise.
[...] Les changements de vitesse de cette catégotie ne se sont pas
généralisés à cause de leur complication et
de leur mauvais rendement ; de plus si l'on n'use pas les dents en les
mettant en prise, on use bien plus rapidement soit les griffes, soit les
petits organes d'embrayage, soit les clavettes que l'on ne peut jamais
faire assez fortes pour résister aux choc violent produit par la
mise en prise brutale d'une vitesse quelconque."
 (pp
216 à 218) (pp
216 à 218)
-
Transmissions
 (pp
219 à 235) (pp
219 à 235)
 (pp
236 à 255) (pp
236 à 255)
p 237 - "Articulations, Joints de Cardan, d'Oldham, etc. ...
qui toutes dérivent, plus ou moins directement, du joint de Cardan
[...] (qui date déjà du seizième siècles)."
 (pp
256 à 269) (pp
256 à 269)
p 258 - Transmission par cardan unique : "... ce tube remplace la jambe
de force, résiste au couple moteur et empêche l'essieu de
culbuter."
p 267 - "Les chaînes, lorsqu'elles ne sont pas trop tendues,
donnent une certaine élasticité à la transmission,
élasticité assurant une meilleure conservation de la partie
mécanique, tandis que dans les voitures à cardans, surtout
celles qui n'ont pas de jambe de force avec amortisseur, il n'y a rien
qui puisse donner un peu de souplesse au mécanisme ; aussi certains
constructeurs ont-ils intercalé un accouplement élastique
entre le changement de vitesse et l'essieu arrière."
 C'est en
1912 que Krebs invente le
joint Flector pour répondre à ce besoin tout en supprimant
le cardan de transmission. C'est en
1912 que Krebs invente le
joint Flector pour répondre à ce besoin tout en supprimant
le cardan de transmission.
-
Table des matières
et Table Alphabétique
|