|
SOMMAIRE
Roulement et
suspension
La direction
Le freinage
Le moteur (éclaté)
Le
moteur alternatif à combustion interne
Le turbocompresseur
Le refroidissement
Les gaz d'échappement
Autres types de
moteur
La transmission
LIENS
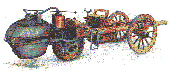
Le fardier de Cugnot

Les motos
L'automobile classique et sportive
La barre Panhard aux États-Unis

L'histoire des techniques de l'automobile
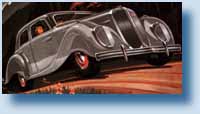
Les dates de l'histoire de l'automobile
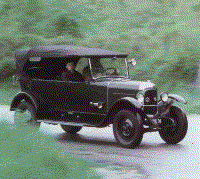
Les premières Citroën
|
Automobile - Description
technique
Une automobile comporte essentiellement une carrosserie
, abritant ses
passagers et leurs bagages, un moteur, une transmission
, quatre roues
suspendues, des dispositifs de commande, d'éclairage
et de
signalisation.
Dans les premières voitures, la carrosserie était
un simple assemblage
de bois puis de tôles légères, embouties
et soudées, sur laquelle étaient
articulés les portières, le capot, le couvercle
du coffre à bagages, et qui
ne participait en rien à la résistance
de l'ensemble. Le seul élément de
rigidité était alors constitué par
un châssis, comportant deux longerons
en profilé métallique, reliés par
des traverses, sur lequel étaient montés
tous les organes susceptibles d'exercer des contraintes
mécaniques
(suspension des roues, moteur, transmission, direction,
pare-chocs ). La
technique du châssis est toujours celle des véhicules
automobiles
industriels (cars et camions) mais elle est maintenant
supplantée, en
matière d'automobiles particulières, par
la technique des coques
autoporteuses. Longerons et traverses sont ainsi intégrés
à la coque et
sont, de ce fait, considérablement allégés.
Cette technique de la coque
autoporteuse s'est essentiellement généralisée
sur les voitures à
conduite intérieure : coach (deux portes et deux
glaces latérales), coupé
(deux portes, quatre glaces), berline (quatre portes,
quatre glaces),
limousine (quatre portes, six glaces), break (conduite
intérieure avec
aménagement arrière mixte pour voyageurs
supplémentaires ou
marchandises). Il n'y a guère que les conduites
intérieures
anormalement longues, comme les superlimousines américaines
(six
portes, huit glaces), et surtout les voitures décapotables
: cabriolet (ou
coupé décapotable), torpédo (ou
berline décapotable), qui continuent à
privilégier le châssis. À l'intérieur
de la carrosserie, l'habitacle comprend
les sièges des passagers, le système complet
de pilotage, le tableau de
bord et les accessoires divers. La carrosserie est équipée,
outre des
portes munies de leurs propres glaces, de glaces fixes
telles que le
pare-brise, de la lunette arrière et, éventuellement,
de glaces latérales de
complément. En plus des portières latérales,
la carrosserie peut
présenter un hayon ou une porte arrière,
ainsi qu'un toit ouvrant, même si
elle est autoporteuse. Elle est pourvue, à l'extérieur,
des organes
d'éclairage réglementaires (phares , combinés
avec les feux de
croisement ou codes , feux de position avant éventuels,
feux rouges
arrière, feux de stop, feux de recul), ainsi que
des rétroviseurs extérieurs,
qui complètent le rétroviseur interne,
permettant au conducteur de
regarder la route, derrière lui, à travers
la lunette arrière.
Roulement et
suspension
Le confort et la tenue de route exigent que les roues
soient suspendues :
leur liaison, directe ou indirecte, avec le châssis
ou la coque est à la fois
élastique et amortie. De même, le pneumatique
assure une liaison
élastique entre la chaussée et la roue,
dotée elle-même d'un
amortissement interne dans le matériau du pneumatique
qui se
déforme. Les roues et les organes qui leur sont
liés oscillent donc entre
deux systèmes élastiques et amortis. La
théorie montre (et l'expérience
confirme) que la qualité d'une suspension est
d'autant meilleure que les
déplacements verticaux de la carrosserie sont
minimisés par rapport à
sa position moyenne (condition essentielle du confort),
que les roues ne
décollent pas de la chaussée après
le passage d'un trou dans le
revêtement, par exemple (condition essentielle
de la tenue de route), que
la masse oscillante intermédiaire est plus faible
(d'où l'engouement
ancien pour les roues à rayons et le succès
actuel des roues en alliage
léger). Il faut noter que la notion de confort
est subjective : la plupart des
Européens préfèrent des suspensions
relativement fermes, à
l'amortissement critique, qui n'oscillent pas après
passage d'une
perturbation, alors que la plupart des Américains
préfèrent des
suspensions plus douces et moins amorties, bien adaptées
à des
revêtements routiers parfaits, mais qui sont génératrices
de nausées,
pour les passagers sensibles, lorsque la voiture est
utilisée sur des
routes médiocres.
À l'origine, les roues avant, directrices, étaient
montées, comme sur les
voitures hippomobiles, aux deux extrémités,
appelées fusées, d'un
essieu rigide sommairement suspendu, qui tournait globalement
par
rapport au châssis. Très vite, on s'aperçoit
qu'il est nécessaire, pour que
les roues restent pratiquement à la même
place par rapport à la
carrosserie et puissent être logées sous
des ailes, que l'essieu reste
parallèle à lui-même, les deux fusées
étant articulées sur lui. Les roues
arrière, motrices et non directrices, sont solidaires
d'un essieu coupé en
son centre par le pont arrière, recevant l'arbre
de transmission venant
des organes propulseurs (généralement situés
à l'avant). Les essieu x
sont suspendus par des ressorts à lames et amortis
par des
amortisseurs mécaniques à friction. Ces
ensembles sont fort lourds
surtout à l'arrière, et associent directement
chaque roue d'un train aux
perturbations subies par l'autre ; les performances des
suspensions
sont, de ce fait, médiocres. On commence par supprimer
l'essieu avant
et à suspendre chaque roue directement sur la
carrosserie ou le châssis
(roues dites indépendantes). Cela exige que chaque
fusée soit portée
par un ensemble déformable, qui peut être
soit un quadrilatère articulé
dont les côtés ont une longueur constante
(la carrosserie ou le châssis
en constituant l'un des côtés verticaux),
soit un triangle articulé
correspondant comportant un long côté vertical
télescopique (la
carrosserie ou le châssis en constituant un côté
quasi vertical rigide).
Dans le premier cas, la déformation du quadrilatère
sollicite un ressort
de suspension (à barre de torsion ou à
boudin) et l'amortisseur. Dans le
second, le côté télescopique est
précisément constitué par l'amortisseur
hydraulique lui-même, obligatoirement situé
dans l'axe d'un ressort à
boudin (suspension dite MacPherson). L'amélioration
de confort et de
tenue de route est telle qu'on cherche à appliquer
cette technique aux
roues arrière : on rend ainsi le pont arrière
fixe (non suspendu) et on le
relie à des roues indépendantes motrices,
par l'intermédiaire de joints
homocinétiques. On s'aperçoit alors que
les joints homocinétiques
ouvrent d'autres possibilités que celle de la
seule transmission du
mouvement à des roues oscillant verticalement.
C'est ainsi que naissent,
dans l'immédiat avant-guerre, les roues avant
indépendantes, à la fois
tractrices et directrices, qui se généralisent
en Europe dans les
décennies suivantes. Le seul inconvénient
de ces dispositifs est, parfois,
de permettre une trop grande inclinaison des carrosseries
vers l'extérieur
en virage rapide et serré ; on y a remédié
en rétablissant une certaine
réaction élastique modérée
entre les deux roues d'un même train, à
l'aide de barres antiroulis. L'ultime progrès
des suspensions a été de
réunir les fonctions de suspension et d'amortissement
dans un même
appareil. Un piston comprime de l'huile dans un cylindre,
l'huile
comprime elle-même un gaz assurant l'élasticité
du dispositif. Un
étranglement sur le circuit d'huile assure l'amortissement,
comme sur un
simple amortisseur hydraulique. Les suspensions correspondantes
sont dites oléopneumatiques. Elles sont toutes
capables de modifier la
hauteur de la carrosserie au-dessus du sol en parcours
tout terrain ou
pour franchir une zone inondée. En position normale,
elles ramènent
toujours à sa valeur moyenne la hauteur de la
coque, au droit de chaque
roue, par rapport au sol, quelle que soit la charge globale
du véhicule et
son déséquilibre éventuel (correction
automatique d'assiette). Elles
s'opposent ainsi notamment à l'apparition d'une
gîte vers l'extérieur, en
virage rapide, et les plus perfectionnées d'entre
elles sont même
capables d'imposer alors une gîte centripète,
analogue à celle que prend
une moto, formule qui constitue un facteur complémentaire
d'amélioration de la tenue de route.
La direction
L'engagement d'une voiture dans un virage est assuré
par braquage des
roues avant, généralement commandé
par une crémaillère transversale
horizontale, contrôlée par un pignon solidaire
du volant de direction.
Dans les voitures modernes, l'arbre reliant le volant
au pignon est brisé,
grâce à deux joints, et se replie sur lui-même
en cas de choc violent à
l'avant, évitant ainsi un type d'accidents très
graves autrefois (le recul d'un
arbre rigide défonçait la cage thoracique
du conducteur). La crémaillère
attaque elle-même, à ses deux extrémités,
des biellettes articulées qui
permettent les oscillations verticales des roues et assurent
la rotation
des fusées et des roues autour d'un axe approximativement
vertical. Pour
éviter tout glissement des pneumatiques sur le
sol, générateur d'usure et
de perte d'adhérence, il importe que les axes
des fusées des roues
avant ne restent pas parallèles, mais convergent
approximativement vers
un point situé sur l'axe des roues arrière,
qui devient ainsi le centre de
courbure commun des trajectoires de chacune des quatre
roues.
Quelques rares automobiles modernes à traction
avant possèdent un
train arrière autodirectionnel : la traction oblique
effectuée sur lui par la
coque en virage entraîne un très léger
braquage des roues arrière dans
le même sens que celui des roues avant et l'inscription
de la voiture
dans des courbes rapides s'en trouve encore améliorée.
Les automobiles militaires d'opération, de type
Jeep , et certains
véhicules civils utilitaires possèdent
un dispositif manuel de crabotage
des roues, normalement non motrices, pour pouvoir bénéficier
de quatre
roues motrices dans les passages difficiles (véhicules
dits 4 × 4 ).
Quelques rares voitures civiles sont maintenant équipées
de quatre
roues motrices en permanence. On en attend une amélioration
générale
de l'adhérence sur route glissante : on manque
toutefois de recul pour en
juger l'efficacité.
Les conducteurs européens préfèrent
généralement des directions
relatives franches, avec lesquelles il n'est pas nécessaire
de donner de
nombreux tours de volant pour assurer le braquage complet.
Les
utilisateurs américains préfèrent
généralement des directions plus
démultipliées, ce qui ne se justifie guère,
car les directions de leurs
voitures sont toutes assistées par un servomoteur
hydraulique, ce qui
supprime tout effort sur le volant (à l'exception
de l'effort résiduel de
sensibilité que l'on maintient volontairement).
Cette habitude résulte
sans doute d'anciennes traditions qui se sont établies
avant la
généralisation de l'assistance. Les voitures
européennes sont
couramment équipées de la direction assistée,
mais celle-ci n'est pas
encore répandue sur les véhicules les plus
légers.
Le freinage
Il est assuré à l'arrêt par un dispositif
mécanique commandé, depuis
l'habitacle, par un levier manuel à encliquetage,
appelé frein à main .Ce
dispositif agit généralement sur un train
de roues ou sur l'arbre de
transmission, entre moteur et roues motrices, lorsque
celui-ci existe.
Dans les voitures à boîte de vitesses automatique,
un second dispositif
provoque le blocage mécanique de la boîte
à l'arrêt. Le freinage en
marche est assuré par un dispositif hydraulique
actionné par une pédale
(pédale centrale dans les voitures classiques),
qui agit sur des
servomoteurs commandant les organes de freinage de chacune
des
quatre roues. Autrefois, ces organes étaient constitués
d'un tambour
cylindrique solidaire de la roue, sur la surface interne
duquel venaient
s'appliquer deux mâchoires fixes portant des matériaux
de friction,
mâchoires que le servomoteur écartait. Ils
ont été remplacés par des
freins à disques, que les servomoteurs font pincer
par des mâchoires
comportant des dispositifs de frottement périphériques
appelés
plaquettes de friction. Certains véhicules possèdent
toutefois des freins
à disques sur le train avant et des freins à
tambour sur le train arrière, où
les efforts de freinage sont moins importants. L'efficacité
des freins, en
usage prolongé, est réduite par l'échauffement
(diminution à chaud du
coefficient de frottement du matériau de friction
sur l'acier). Les freins à
disques sont moins sensibles à l'échauffement
que les freins à tambour,
surtout s'ils sont artificiellement ventilés,
ce qui est le cas du train avant
de certaines voitures puissantes et rapides. Ils sont
également plus
faciles à entretenir (le changement des plaquettes
est aisé, alors que le
changement des garnitures de frottement des mâchoires
de freins à
tambour est une opération longue et coûteuse).
Ils sont enfin plus légers,
ce qui améliore les performances de la suspension.
Le freinage hydraulique centralisé délivre
un effort de freinage équilibré
sur les roues droites et sur les roues gauches. Il comporte
un dispositif
limitant l'effort sur les roues arrière, qui doivent
freiner moins que les
roues avant, sous peine de commencer à glisser.
L'équilibrage des
efforts ne suffit pas, cependant, à garantir l'équilibrage
des effets : l'usure
des éléments de friction peut être
dissymétrique et, surtout, le coefficient
de frottement entre une roue et la route peut être
différent pour chacune
des quatre roues. Un freinage brutal risque d'entraîner
le blocage d'une
ou de plusieurs roues avec, comme conséquence,
une perte
d'adhérence qui diminue l'efficacité globale
du freinage, engendre un
dérapage latéral, annule l'effet de la
direction s'il se produit sur les roues
avant. D'où la faveur de plus en plus grande que
rencontrent les
systèmes antibloquants (ABS ) qui contrôlent
en permanence la vitesse
des quatre roues grâce à des capteurs électroniques
à impulsion,
détectent en temps réel le ralentissement
relatif d'une ou de plusieurs
roues et relâchent alors immédiatement l'effort
de freinage sur le ou les
servomoteurs concernés. Il est ainsi possible
de maintenir la voiture sur
sa trajectoire, même par freinage intense sur route
glissante, tout en
maintenant l'intensité maximale du freinage et
l'efficacité de la direction.
Le moteur
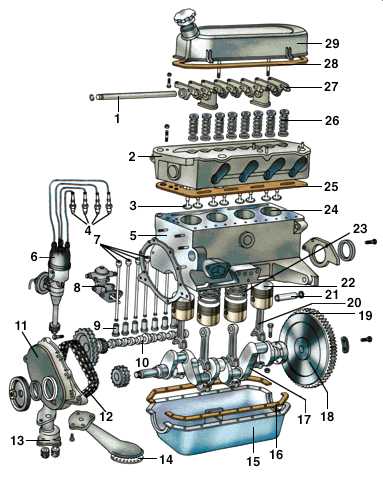
Vue éclatée d'un moteur à
explosion.
(c) IGDA
1) Axe des culbuteurs ; 2) culasse ; 3) soupapes ; 4) bougies
; 5) bloc ; 6)
allumeur; 7) tiges de commande des culbuteurs ; 8) pompe
à essence ;
9) poussoirs ; 10) arbre à cames ; 11) carter
de distribution ; 12) chaîne
de distribution ; 13) pompe à huile ; 14) crépine
de pompe à huile ; 15)
carter d'huile ; 16) joint de carter ; 17) vilebrequin
; 18) volant moteur ; 19)
couronne dentée entraînée par le
démarreur ; 20) bielle ; 21) axe de
piston; 22) piston ; 23) segments ; 24) cylindre ; 25)
joint de culasse ; 26)
ressorts de soupapes ; 27) culbuteurs ; 28) joint de
cache-culbuteurs ;
29) cache-culbuteurs.
Le
moteur alternatif à combustion interne
Concurrencé depuis les origines par le moteur électrique,
puis par les
moteurs à explosion rotatifs, et enfin par les
moteurs à turbines à gaz, le
moteur alternatif à combustion interne (à
explosion ou Diesel) a atteint un
si haut niveau de qualité, dans une technique
de base séculaire, qu'il n'a
pu, jusqu'à présent, être détrôné.
Quelques rares utilisations de moteurs
alternatifs à deux temps ont maintenant disparu.
Tous les autres sont à
quatre temps et à quatre cylindres au minimum
(quelques réalisations
comportant deux cylindres à plat ont également
disparu).
Le moteur le plus répandu est le moteur à
quatre cylindres en ligne
refroidi par eau, comportant un temps moteur par tour,
et présentant un
ordre d'allumage 1-3-4-2. Son couple n'est pas suffisamment
régulier et
il doit être doté d'un volant d'inertie
important, peu favorable aux très
fortes accélérations. Son équilibrage
mécanique est médiocre et il
engendre des vibrations. Son couple moyen décroît
assez rapidement,
au-dessous de la vitesse pour laquelle il est maximal,
ce qui limite sa
souplesse à bas régime. Mais il est robuste,
simple à fabriquer, bon
marché, et il a reçu de si nombreux perfectionnements
qu'il s'impose sur
toutes les voitures qui ne sont pas haut de gamme. Il
existe quelques
moteurs à quatre cylindres à plat, refroidis
par air, qui sont
mécaniquement un peu mieux équilibrés,
mais qui ne se sont pas
imposés. Une grande amélioration est obtenue
avec les moteurs à six
cylindres, soit en ligne, soit, de préférence,
en V (deux rangées de trois
cylindres en ligne, inclinées l'une par rapport
à l'autre, utilisant le même
vilebrequin). Les Américains, quant à eux,
sont fidèles au moteur à huit
cylindres en V, plus complexe, mais qu'ils ont perfectionné
pour équiper
leurs automobiles de séries à prix compétitifs.
Ils en recherchent
essentiellement le silence et la remarquable souplesse
à bas régime, le
couple de ces moteurs variant peu dans une très
large plage de vitesse.
Le turbocompresseur
Les perfectionnements les plus récents apportés
aux moteurs à
combustion interne portent sur : leur vitesse de rotation
; le taux de
remplissage de leurs cylindres, lié à la
perte de charge dans les
soupapes d'admission et d'échappement, surtout
à bas régime, et qui
incite à multiplier le nombre des soupapes par
cylindre ; la
suralimentation éventuelle par un groupe turbocompresseur
(ou turbo ),
entraîné par l'énergie résiduelle
disponible sur les gaz d'échappement. Il
faut toutefois insister sur le fait que le seul avantage
du turbo est de
permettre à un moteur donné de produire
une puissance plus
importante. Mais il n'améliore pas le rendement
de ce moteur et le
dégrade même légèrement. Le
débat reste vif, actuellement, dans les
services techniques des constructeurs de voitures haut
de gamme, entre
les partisans de moteurs atmosphériques plus gros
et les partisans de
moteurs suralimentés par turbo, ces derniers étant
souvent encouragés
par les services commerciaux, pour lesquels le label
" turbo " est un
argument de vente.
En ce qui concerne les seuls moteurs à explosion
, ils ont reçu quelques
perfectionnements complémentaires spécifiques,
avec le remplacement
du carburateur par l'injection d'essence, dite indirecte,
dans les tubulures
d'admission, et avec la généralisation
de l'allumage électronique, sans
pièces mobiles, susceptible d'être automatiquement
optimisé en
fonction de nombreux facteurs, comme la vitesse de rotation
du moteur,
son régime d'alimentation, etc.
Le refroidissement
dit à l'eau de presque tous ces moteurs est en
fait assuré par un circuit
fermé étanche d'une solution aqueuse renfermant
des additifs
anticorrosion et de l'antigel . Le liquide de refroidissement
se réchauffe à
l'intérieur même du bloc-moteur. Il est
ensuite pompé à la partie
supérieure d'un échangeur eau-air composé
de tubes d'eau verticaux,
ailetés côté air, appelé radiateur,
et - après refroidissement - retourne au
moteur. Son débit est contrôlé par
un thermostat à action directe, situé à
la sortie du bloc-moteur, qui ferme le circuit, à
froid, pour accélérer la
mise en température du liquide, au démarrage,
jusqu'à sa température
optimale voisine de 100 o C, et qui s'ouvre ensuite pour
maintenir
constante cette température. La circulation d'air
dans le radiateur est
assurée, sur route, par le seul déplacement
de l'automobile et, à basse
vitesse ainsi qu'à l'arrêt, par un ventilateur
qui se met en marche, sous la
commande d'un thermostat électrique, lorsque la
température du fluide
refroidi devient trop élevée. Une dérivation
sur le circuit d'eau chaude
alimente un radiateur secondaire, affecté au chauffage
de l'habitacle.
Tous ces moteurs sont à démarrage électrique,
grâce à un démarreur
alimenté par une batterie, qui dessert tous les
autres équipements
électriques de bord et qui est, elle-même,
rechargée par un alternateur
entraîné par le moteur (par l'intermédiaire
d'un redresseur).
Le régime de ces moteurs est commandé par
une pédale, l'accélérateur,
qui agit sur un volet placé dans la tubulure d'admission
du mélange
air-essence (moteurs à carburateur) ou dans la
tubulure d'admission
d'air des moteurs à injection (à essence
ou Diesel) et qui, dans ce
dernier cas, contrôle également le débit
de la pompe d'injection.
Les gaz d'échappement
libérés sous pression résiduelle
non négligeable au moment de
l'ouverture des soupapes d'échappement, traversent
éventuellement la
turbine d'un turbocompresseur, et vont se détendre
ou achever leur
détente dans un pot d'échappement , capacité
cloisonnée servant
d'amortisseur sonore, avant d'être rejetés
à l'arrière du véhicule. Ils
contiennent divers produits polluants : oxyde de carbone
, oxydes d'azote
imbrûlés, produits de dégradations
des antidétonnants
organométalliques (plomb tétraéthyle),
etc., qui induisent des nuisances
sévères en zone urbaine. L'abandon progressif
des additifs
organométalliques permet de généraliser
les pots catalytiques, qui
complètent la combustion des imbrûlés
et de l'oxyde de carbone, et
détruisent en partie les oxydes d'azote.
Autres types de
moteur
En concurrence avec le moteur alternatif, le moteur rotatif
Wankel a
remporté un vrai succès d'estime en raison
de son extrême ingéniosité.
Mais il s'est révélé définitivement
handicapé par l'impossibilité de
maîtriser correctement les problèmes d'étanchéité
entre son rotor
tournant et son stator. Il a, de ce fait, aujourd'hui
disparu des applications
commerciales. L'avenir de la turbine à gaz, quant
à lui, dépend
essentiellement de l'aptitude des constructeurs à
mettre au point un
échangeur de chaleur très efficace, mais
très compact, entre les gaz
d'échappement très chauds (à la
pression atmosphérique) et l'air
d'alimentation de la chambre de combustion (à
environ 12 bars). Ils n'y
sont pas encore parvenus, mais certains bureaux d'études
y travaillent
très activement. En cas de succès, la transmission
aux roues se fera
vraisemblablement par l'intermédiaire d'une génératrice
électrique de
courant continu particulière, tournant à
la vitesse de la turbine, et
alimentant un moteur individuel par roue.
Les voitures électriques à accumulateur
constituent un domaine qui n'a
jamais été abandonné depuis les
débuts de l'automobile. Malgré
l'extrême lourdeur des accumulateurs, le Belge
Camille Jonatzy
construisit en effet, en 1899, un engin capable de monter
à plus de 100
km/h et de rouler quelques minutes, mais aucune réalisation
ne suivit.
De décennie en décennie, quelques nouveaux
prototypes furent
expérimentés. Mais un regain d'intérêt
se manifeste de nos jours, en
grande partie suscité par la nécessité
de réduire la pollution
atmosphérique dans les grandes villes. L'amélioration,
bien qu'encore
modeste, des accumulateurs a permis de construire des
voitures,
affectées à des services municipaux ou
à des services publics, qui
n'exigent qu'une utilisation strictement urbaine, et
n'imposent pas de
longs parcours interurbains. Les perspectives actuelles
d'évolution des
accumulateurs sont, par ailleurs, assez prometteuses.
D'intéressants projets de véhicules électriques
urbains banalisés
s'initient, véhicules que l'on pourrait " emprunter
" grâce à une carte
d'abonnement, dans de nombreuses stations où ces
véhicules se
rechargeraient automatiquement par induction, sans établissement
d'aucune connexion électrique matérielle,
dès l'instant où ils y auraient
été déposés.
Il existe enfin, au Japon, un projet futuriste d'un véhicule
électrique " dual "
combinant, en ville, une alimentation de ses moteurs
par accumulateurs
et, sur route, une alimentation de ces mêmes moteurs
par une
génératrice entraînée par
une turbine à gaz. Sur route, cette génératrice
rechargerait également les accus pour permettre
une utilisation urbaine
momentanée du véhicule. En usage urbain
prolongé, les techniques de
recharge classiques resteraient appliquées.
La transmission
La transmission de la puissance du moteur aux roues se
fait,
classiquement, par l'intermédiaire :
- d'un embrayage à friction, normalement
en prise sous
l'action de ressorts, mais que
l'on peut libérer par l'action sur
une pédale, dite d'embrayage
, qui est la plus à gauche des
trois pédales habituelles
(accélérateur, freins, embrayage) ;
- d'une boîte de vitesses mécanique
à plusieurs rapports
avant et un rapport arrière,
qui permet de maintenir le moteur
dans une plage de vitesse de
rotation qui lui convient (dans
laquelle, en particulier, la
valeur de son couple est
suffisante), quelle que soit
la vitesse du véhicule ;
- d'un arbre de transmission éventuel
si le moteur est à l'avant
et les roues motrices à
l'arrière ;
- d'un pont comportant un renvoi d'angle
entre l'axe de l'arbre
de transmission et celui des
roues, pont qui comporte un
différentiel incorporé,
permettant aux deux roues motrices de
ne pas tourner à la même
vitesse, si la voiture est engagée
dans un virage. Lorsque le moteur
est à la hauteur des roues
motrices (tout à l'avant
ou tout à l'arrière), le renvoi d'angle et
le différentiel sont
généralement incorporés dans le carter de
la boîte de vitesses.
Les véhicules à quatre roues motrices
possèdent toujours un
arbre de transmission, deux
différentiels de pont
et un différentiel d'arbre.
Les boîtes de vitesses mécaniques comportent
un arbre d'entrée et un
arbre de sortie coaxiaux et un arbre intermédiaire
décalé, entraîné en
permanence par l'arbre d'entrée (par l'intermédiaire
d'un couple
d'engrenages). Cet arbre intermédiaire porte autant
d'engrenages qu'il y
a de rapports (généralement quatre ou cinq
rapports avant et un rapport
arrière), moins un. Chacun de ces engrenages entraîne
un engrenage
homologue monté fou sur l'arbre de sortie (ils
tournent librement sur lui,
sans l'entraîner). Un engrenage intermédiaire
est inséré, pour le rapport
arrière, entre l'engrenage de l'arbre intermédiaire
et celui de l'arbre de
sortie. L'arbre de sortie porte également des
baladeurs qui tournent avec
lui tout en pouvant coulisser axialement grâce
à des cannelures.
L'enclenchement d'un rapport se produit, après
avoir débrayé pour
désolidariser du moteur l'arbre d'entrée
et l'arbre intermédiaire, en
faisant coulisser l'un de ces baladeurs. Dans un premier
temps, il vient
frotter sur le flanc d'un engrenage fou. Il en résulte
une synchronisation,
avec l'arbre de sortie, de cet engrenage, et, par son
intermédiaire, de
l'arbre intermédiaire et de l'arbre d'entrée.
Dans un deuxième temps, le
baladeur se crabote définitivement sur l'engrenage
synchronisé. Il est
alors possible de relâcher la pédale d'embrayage
et de rétablir la
continuité moteur-roues sur le rapport choisi.
On économise un train
d'engrenage en prévoyant un baladeur particulier
qui synchronise puis
crabote directement l'arbre d'entrée sur l'arbre
de sortie (prise directe).
Les baladeurs sont à simple ou à double
effet : dans ce dernier cas, ils
synchronisent un rapport en coulissant dans un sens,
et un autre rapport
en coulissant dans l'autre sens. Les baladeurs sont commandés
par
des fourchettes, engagées dans une gorge à
leur périphérie, fourchettes
solidaires de coulisseaux glissant sur des tiges lisses
fixes. Au point
mort de la boîte, tous les baladeurs sont en position
neutre et tous les
coulisseaux (3 ou 4 généralement) sont
à côté les uns des autres,
alignés sur une droite perpendiculaire aux arbres.
Le levier de
changement de vitesse, articulé sur une rotule,
peut se déplacer
latéralement et engager son extrémité
inférieure dans des rainures
usinées à la partie supérieure de
chaque coulisseau. Lorsqu'un
coulisseau a ainsi été sélectionné,
il suffit de pousser le levier en avant
ou de le tirer en arrière, pour faire reculer
ou avancer le coulisseau
correspondant, sa fourchette, le baladeur, et enclencher
ainsi un rapport.
Un tel dispositif interdit de sélectionner un
autre baladeur, avant d'avoir
ramené le précédent au point mort.
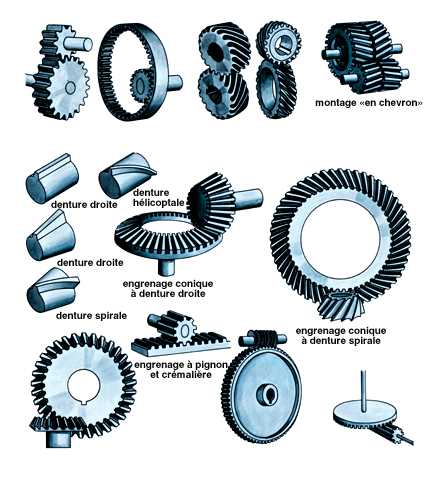
Les boîtes de vitesses mécaniques sont de
plus en plus concurrencées
par les boîtes de vitesses automatiques, qu'elles
ont même totalement
supplantées aux États-Unis. Les boîtes
automatiques sont, le plus
souvent, des boîtes classiques à trois vitesses,
automatiquement
télécommandées, en fonction de la
vitesse du moteur et de la puissance
qui lui est demandée. L'embrayage mécanique
et sa pédale sont
supprimés et remplacés par un coupleur
hydraulique. Un sélecteur
manuel de commande comporte deux positions principales
: marche
arrière et conduite normale. En conduite normale,
lorsque la voiture est
arrêtée et que le moteur tourne au ralenti,
le coupleur ne transmet aucun
couple appréciable. Il suffit d'accélérer
progressivement le moteur pour
démarrer la voiture et l'accélérer,
jusqu'à ce que la commande
automatique passe la vitesse suivante, etc. Pour assurer
une forte
accélération, par exemple pour dépasser
un camion, il faut écraser la
pédale d'accélérateur, ce qui provoque
une rétrogradation immédiate à la
vitesse inférieure. Le sélecteur possède
également une position de
blocage en stationnement (il suffit, par exemple, d'enclencher
simultanément deux rapports différents,
ce qui est impossible dans une
boîte mécanique), et une ou deux positions
de verrouillage sur le premier
et le deuxième rapport, positions utilisées
uniquement à basse vitesse,
dans des passages particulièrement difficiles.
Les différentiels attaquent les deux demi-arbres
entraînant
respectivement les roues motrices droite et gauche, par
l'intermédiaire
de deux engrenages coniques, ou planétaires, montés
à leurs
extrémités. Ces deux planétaires
sont placés à l'intérieur d'une cage
rotative solidaire du mouvement à transmettre,
provenant du moteur.
Cette cage porte plusieurs engrenages coniques, ou satellites,
en prise
avec les planétaires (leurs axes sont perpendiculaires).
Lorsque la cage
tourne et que la voiture est engagée en ligne
droite, l'ensemble constitué
par la cage, les satellites et les planétaires
se comporte comme un
ensemble monobloc : les satellites suivent le mouvement
de la cage
mais ne tournent pas sur eux-mêmes, les deux planétaires
tournent à la
même vitesse. Si la voiture s'engage dans un virage,
les trajectoires
suivies par les deux roues motrices sont différentes
et leur adhérence
sur le sol les oblige à tourner à des vitesses
également différentes. Les
satellites tournent alors sur eux-mêmes. Le mouvement
de la cage est
toujours transmis aux planétaires, mais la rotation
des satellites permet
d'adapter le dispositif aux vitesses de rotation différentes
des roues, dont
la moyenne arithmétique reste alors égale
à celle de la cage.
L'inconvénient principal d'un tel dispositif est
que la perte d'adhérence
d'une roue (patinage ) entraîne l'immobilisation
du véhicule. La roue qui
patine accélère, en effet, jusqu'au double
de la vitesse de la cage, et la
roue qui ne patine pas s'arrête. Cela explique
l'apparition, surtout chez
des véhicules destinés à des conditions
d'utilisations difficiles, de
différentiels plus complexes qui, en cas de début
d'accélération
intempestif d'une roue, sont autobloquants.
Voir aussi : http://www.webencyclo.fr/
(c) Editions Atlas
1999
WACS
L'automobile Classique et
sportive
"Technique" : http://www.motorlegend.com/wacs/vrac/edefault.htm
Panhard Bars: The Rest of
the Story!
La
barre Panhard aux États-Unis
|











